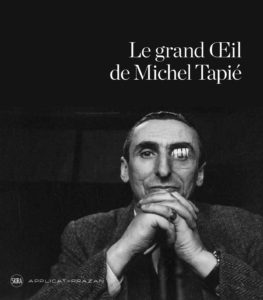Tout est à refaire
C’est au sortir de la guerre, au temps d’une libération et d’une reconstruction qui s’étendra à l’expression picturale, que Georges Mathieu et Michel Tapié ont œuvré de concert à la reconnaissance d’un nouvel art. Celui-ci, bien que revêtant des terminologies variées selon leur promoteur — abstraction lyrique [i], informel, art autre, tachisme — pouvait se définir par une même volonté de redéfinir les possibles au-delà des frontières déjà explorées par le cubisme, le surréalisme et l’abstractivisme géométrique, loin de tout déterminisme ou formalisme. Si la collaboration de Mathieu et Tapié n’a démarré qu’en 1948, c’est l’année précédente qui recèle les prémices de ce projet audacieux.
Georges Mathieu sort foudroyé et bouleversé de l’exposition historique de quarante toiles de Wols [ii] qui s’ouvre le 23 mai 1947 à la galerie René Drouin : « Wols a tout pulvérisé. […] Après Wols, tout [iii] est à refaire[iv]. » Participant au deuxième Salon des réalités nouvelles, où il présente trois toiles réalisées à même le sol [v], puis au 14e Salon des surindépendants, où il envoie deux toiles [vi], Mathieu reçoit les encouragements du critique d’art Jean-José Marchand qui trouve ses toiles « très lyriques, extrêmement émouvantes [vii] ».
« L’imaginaire », première exposition de combat pour l’abstraction lyrique
C’est dans ce contexte de choc artistique et de début de reconnaissance critique que Mathieu se lance avec ardeur dans l’exécution de son projet qui est de « réunir tout ce [qu’il] estime constituer ce qu’il y a de plus vivant, rassembler les œuvres dans une exposition […] en révélant comment et pourquoi cette peinture qui naît n’a rien à voir avec ce qui continue d’être montré comme contemporain [viii] ». Avec Camille Bryen, il soumet ce projet à Éva Philippe qui dirige la galerie du Luxembourg. Ils l’invitent à exposer en complément de leurs propres œuvres celles de Hans Hartung, Jean-Michel Atlan, Wols, Jean Arp, Jean-Paul Riopelle et Fernand Leduc. L’exposition débute le 16 décembre 1947 sous le nom « L’imaginaire ». Dans son texte de présentation, Jean-José Marchand emploie l’expression d’« abstractivisme lyrique » et conclut ainsi : « Désormais la voie est libre. C’est aux peintres de nous montrer comment ils utilisent cette liberté. » Le coup de départ de l’abstraction lyrique est donné [ix].
« H.W.P.S.M.T.B. »
Nous sommes désormais en 1948 et, fort du rôle de chef de file nouvellement endossé, Georges Mathieu accepte la proposition qui lui est faite par Colette Allendy d’organiser une nouvelle exposition collective dans sa galerie. Il décide d’y ajouter les sculptures de François Stahly et de Michel Tapié, remarquant au sujet de ces dernières qu’elles ont le grand mérite de « déplaire furieusement à Charles Estienne [x] » dont Tapié deviendra le rival dans le cercle très fermé des critiques d’art français. L’exposition « H.W.P.S.M.T.B. » réunit Hartung, Wols, Picabia, Stahly, Mathieu, Tapié et Bryen. Plusieurs d’entre eux écrivent des textes pour le catalogue qui devient dès lors un manifeste multiple. Celui de Mathieu s’intitule « La liberté c’est le vide » et conclut à une libération conjointe des différentes formes d’expression. Tapié plaide, lui, pour conjuguer la liberté de création au présent, « au jour le jour », loin de tout automatisme.
À partir de cette exposition, leur amitié se nouant, Tapié fera cause commune avec Mathieu, dans une répartition des rôles qui verra Mathieu se concentrer sur celui d’artiste, et Tapié sur celui de critique d’art, s’appuyant sur les œuvres et la renommée de Mathieu pour concrétiser sa vision critique.
« White and Black »
En juillet est présentée à la galerie des Deux Îles, récemment créée par Florence Bank [xi] l’exposition « White and Black » où sont présentés dessins, gravures et lithographies monochromes de Arp, Bryen, Fautrier, Germain, Hartung, Mathieu, Picabia, Tapié, Ubac et Wols. Mathieu demande un texte au critique d’art Édouard Jaguer ainsi qu’à Michel Tapié dont ce sera la dernière participation en tant qu’artiste. Tapié y vante les mérites d’une liberté créatrice décorsetée des notions de style et de composition, et introduit le concept d’informe [xii] qu’il développera plus tard sous le nom d’informel [xiii].
Mathieu est conscient que si, « en cette fin de 1948, les manifestations de pur combat ont eu lieu, la victoire n’en est pas décisive pour autant [xiv] ». Dès lors, il passe implicitement le témoin à Tapié, non sans craindre les équivoques qui pourraient s’ensuivre : « Conscient d’avoir accompli mon rôle, d’avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir de faire, je sais que le temps est de mon côté, que la vérité finira par éclater au grand jour, que cette Abstraction libre triomphera fatalement et je devine même qu’elle risquera de donner lieu aux plus grandes confusions, aux plus grandes facilités. »
Galerie René Drouin, première exposition personnelle de Mathieu à Paris
C’est en mai 1950, à la galerie René Drouin où Michel Tapié est désormais conseiller artistique, que Mathieu obtient sa première exposition personnelle à Paris [xv]. À cette occasion est publié en édition très limitée un poème d’Emmanuel Looten, La Complainte sauvage, qui est « orné de signes de Georges Mathieu » juxtaposés sur le texte [xvi]. Dans son texte intitulé Dégagement, Tapié affirme que c’est faire « confiance à l’Homme que de lui donner un risque à courir [xvii] ». Mathieu développera également la thématique de l’esthétique du risque [xviii].
« Véhémences confrontées », première passerelle entre l’Europe et les États-Unis
Mathieu, responsable depuis 1947 des relations publiques de la compagnie maritime transatlantique United States Lines [xix], est conscient des « recherches concomitantes » menées aux États-Unis notamment par Pollock, De Kooning, Tobey [xx], alors ignorées en Europe, et souhaite les défendre à Paris en novembre 1948 à la galerie du Montparnasse [xxi]. Toutes les œuvres souhaitées ne pouvant être obtenues [xxii], ce projet trouvera son aboutissement [xxiii] en mars 1951 à la galerie Nina Dausset, après que Tapié aura proposé à Mathieu d’organiser avec lui une nouvelle confrontation parisiano-américaine.
Cette exposition historique est nommée « Véhémences confrontées », en référence aux termes « véhémentes » et « soufrées » employés par André Malraux lorsque Tapié lui présenta pour la première fois les œuvres de Mathieu à la galerie Drouin [xxiv]. Elle réunira les œuvres de Bryen, Capogrossi, De Kooning, Hartung, Mathieu, Pollock, Riopelle, Russell et Wols.
Dans la grande « affiche-manifeste » qui tient lieu de catalogue, Tapié parle d’informel, ouvrant la porte à un schisme théorique avec Mathieu dont les signes sont incompatibles avec le concept d’informel.
Le portrait de Tapié selon Mathieu
À l’occasion de l’exposition « Véhémences confrontées », Mathieu fait paraître dans le magazine anglophone Paris News Post [xxv] un portrait de Michel Tapié qu’il débute ainsi : « Il est extrêmement rare de rencontrer un esprit humain présentant les caractéristiques étrangement assorties de la logique, du mysticisme et du Dada [xxvi]. »
Féru d’histoire, Mathieu [xxvii] décrit un Tapié « écrasé par un passé trop chargé de tradition, de religion, de faits glorieux (ses ancêtres commandaient une des quatre armées féodales de la première croisade) [qui] ne pouvait qu’avoir une attitude prédominante de refus : refus de l’action par nature, refus du travail par habitude, refus de la preuve par éducation, refus de la cohérence, ou au moins de l’unité, par contagion. »
Ce « cynique du dilettantisme » étonne et séduit Mathieu par « son extraordinaire capacité d’investigation et d’osmose dans les domaines du nombre, du monde sonore et du monde visuel ». Tapié tient réciproquement Mathieu en grande estime, lui écrivant la même année : « Les cris des silencieux de votre espèce présentent toujours pour moi le plus haut intérêt […] [xxviii] »
Hommage au maréchal de Turenne : l’action painting mis en scène pour la première fois, au Studio Facchetti
En 1951, à la fermeture de la galerie Drouin, place Vendôme, Mathieu présente Tapié au photographe Paul Facchetti qu’il connaît depuis 1948 [xxix] et qu’il encourage « vivement à ouvrir une galerie d’art ». Facchetti engage alors Tapié comme conseiller artistique de sa galerie ouverte en octobre, le « Studio Facchetti ». En novembre débute l’exposition collective « Signifiants de l’informel », initiée par Tapié, où sont représentés Dubuffet, Fautrier, Mathieu, Michaux, Riopelle et Serpan.
Tapié organise en janvier 1952, toujours au Studio Facchetti, une nouvelle exposition personnelle de Mathieu intitulée « Le message signifiant de Georges Mathieu ».
Parmi les cinq œuvres exposées, deux se réfèrent directement à Tapié : Hommage hérétique (1951, dédicacé « Pour Michel Tapié »), en référence à ses origines cathares si ce n’est à ses positions sur l’informel, ainsi qu’Hommage à Machiavel (1952), Mathieu ayant employé les termes de machiavélisme lucide à son égard.
Tapié débute le catalogue d’exposition par cette appréciation : « Arriver au « style » en évitant tous les pièges académiques n’est pas la moindre des stupéfactions que nous éprouvons devant les œuvres de Georges Mathieu » et conclut que Mathieu « se permet ce qui peut passer pour la plus périlleuse gageure de notre temps actuel : l’élégance ».
En se faisant photographier le 19 janvier 1952, la veille du vernissage, alors qu’il réalisait son fameux Hommage au maréchal de Turenne [xxx] sur le lieu de son exposition, Georges Mathieu devient « le premier à mettre en scène des peintures d’action en direct [xxxi] », permettant à Facchetti d’immortaliser « l’un des premiers happenings [xxxii] ».
L’exposition est reprise la même année à la Stable Gallery à New York par Alexander Iolas. Cette première exposition personnelle de Mathieu à New York, intitulée « The Significant Message of Georges Mathieu », permettra au New York Times[xxxiii] de dire que « Mathieu est un virtuose du pinceau ».
Un art autre
En décembre 1952, Michel Tapié publie un livre-manifeste intitulé Un art autre [xxxiv] qui sera accompagné d’une exposition au Studio Facchetti. Dans cet ouvrage jalon de l’histoire de l’art, Tapié offre une place de choix au « lucide Georges Mathieu [xxxv] » dont six toiles sont reproduites [xxxvi] aux côtés de Pollock, Sam Francis, Dubuffet, Soulages, Hartung, Wols, Michaux, Riopelle, Fautrier, Appel. L’informel, que Tapié définit de façon souvent alambiquée dans la rhétorique lyrique et mystique qu’il affectionne, est augmenté par le concept plus souple, mais tout aussi sibyllin, d’un art autre, étendu selon Mathieu à un « mélange de surréalistes, d’expressionnistes, d’abstraits, de figuratifs [xxxvii] ».
La Bataille de Bouvines
Le 25 avril 1954, Georges Mathieu peint son emblématique Bataille de Bouvines [xxxviii], toile monumentale mesurant 2,50 m x 6 m, en présence de Michel Tapié et d’Emmanuel Looten, sous l’œil de la caméra de Robert Descharnes. Mathieu passe ainsi de la photographie au film dans la documentation de son travail. Tapié décrit la naissance de cette « œuvre-clé » dans un livret intitulé 1214 illustré d’images extraites du film de Descharnes, ainsi que dans une publication sur quatre pages en anglais, en février 1955, dans la revue américaine ARTnews sous le nom Mathieu Paints a Picture [xxxix].
Les Capétiens partout !
En 1954, Michel Tapié quitte le Studio Facchetti pour s’occuper jusqu’en 1956 de la galerie Rive Droite de Jean Larcade, où il obtient le « rôle de conseiller, de débatteur, de découvreur et de défenseur de l’art vivant [xl] ».
Le 10 octobre 1954, Mathieu réalise en une heure vingt sa célèbre peinture Les Capétiens partout ! [xli] sur le terrain du château appartenant au père de Jean Larcade à Saint-Germain-en-Laye, en présence des reporters du magazine américain Life, Gabrielle Smith et Dmitri Kessel.
Trois semaines plus tard, cette œuvre magistrale est transportée à la galerie Rive Droite qui proposera une exposition personnelle du même nom durant le mois de novembre. Le catalogue d’exposition offre des textes de Michel Tapié, du philosophe Stéphane Lupasco et du peintre américain Mark Tobey. Tapié voit en Mathieu l’un des « quelques Individus dignes de ce nom dans l’aventure de cet art autre ».
Jean Larcade, impressionné par la bravoure et le sérieux de Mathieu [xlii], fera don des Capétiens partout ! au Musée national d’art moderne [xliii] en 1956. Il s’agira de la première œuvre de Mathieu dans un musée français, plusieurs années après les acquisitions du musée d’Art moderne de Rio de Janeiro, de l’Art Institute de Chicago et de la Fondation Solomon Guggenheim de New York [xliv].
Le Couronnement de Charlemagne
En mai 1956, la galerie Rive Droite présente une nouvelle exposition personnelle de Mathieu. En exposant ses toiles récentes « sous des baldaquins carolingiens [xlv] » tandis qu’il joue costumé le rôle de Charlemagne dans un court-métrage de Robert Descharnes intitulé Le Couronnement de Charlemagne auquel participe Michel Tapié, Mathieu veut « réintroduire la notion de jeu dans l’art et dans la culture [xlvi] » et ce uniquement « dans la présentation et non dans l’exécution des œuvres ».
La même année paraît en anglais le livre hommage Observations of Michel Tapié [xlvii] édité par Paul et Esther Jenkins [xlviii]. Mathieu le clôt par une note biographique sur Tapié : « son activité durant les dix dernières années se révèle d’une importance majeure. » Il « aura eu le grand mérite de s’aventurer dans [le domaine de la peinture et de la sculpture] avec des capacités extraordinaires d’investigation et une perspicacité foudroyante [xlix] ».
L’informel au Japon, à la rencontre de Gutaï
À partir de 1955, Tapié travaille désormais pour la galerie de Rodolphe Stadler qui est impressionné par « sa culture extravagante […] autant que son enthousiasme [l] ».
En novembre 1956 le journal japonais Asahi organise au grand magasin Takashimaya [li] l’exposition d’art contemporain « Sekai Konnichi no Bijutsuten » (exposition internationale de l’art actuel) qui sera la première à présenter de l’art informel au Japon à travers dix-sept œuvres provenant de la collection personnelle de Tapié [lii]. Les œuvres de Georges Mathieu, Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Sam Francis, Willem De Kooning et Mark Tobey suscitent le plus d’intérêt [liii].
Tapié prévoit de rencontrer le mouvement d’avant-garde japonais Gutaï [liv], d’inspiration Dada et qu’il souhaite voir rejoindre les rangs de l’art informel, dès lors qu’il se rendra au Japon pour la première fois [lv]. Yoshihara, fondateur et théoricien du mouvement, avait écrit l’année précédente dans le manifeste de l’art Gutaï [lvi] que les membres de Gutaï avaient « le plus grand respect pour Pollock et Mathieu car leurs œuvres révèlent le hurlement poussé par la matière, les cris des pigments et des vernis ». Le projet d’exposition de Mathieu au Japon en 1957 donne l’occasion à Tapié de s’y rendre [lvii].
Mathieu arrive à Tōkyō le 29 août et exécute « vingt et une toiles en trois jours [lviii] » devant de nombreux journalistes, dont la spectaculaire Bataille de Hakata [lix] mesurant 2 m par 8 m et réalisée en 110 minutes. Le jour d’ouverture de l’exposition au grand magasin Shirokiya, qui recevra du 3 au 8 septembre « plus de 25 000 visiteurs [lx] », Mathieu réalise une imposante fresque de 15 m de long, la Bataille de Bun’ei [lxi], sous les yeux d’un public dense massé devant la vitrine.
Le 5 septembre, Mathieu accueille Tapié à l’aéroport de Tōkyō, accompagné du peintre Toshimitsu Imaï, du peintre et sculpteur Sōfū Teshigahara [lxii], du peintre surréaliste et critique d’art Shūzō Takiguchi, du critique d’art Sōichi Tominaga [lxiii], de Yoshihara qui représente Gutaï, et de Hideo Kaītō du quotidien Yomiuri Shimbun [lxiv]. Avant leur départ pour Ōsaka, Mathieu et Tapié visitent l’atelier de Teshigahara.
Le 10 septembre, Mathieu, Imaï et Tapié sont accueillis à la gare d’Ōsaka par les membres de Gutaï. Mathieu exécute en public le 12 septembre « six toiles dont une de 3 m sur 6 m, Hommage au général Hideyoshi [lxv] » sur le toit du grand magasin Daïmaru pour une exposition s’y tenant du 12 au 15 septembre et qui montre également les œuvres peintes à Tōkyō [lxvi]. Puis Mathieu et Tapié rendent visite au domicile de Yoshihara pour regarder les œuvres d’artistes de Gutaï [lxvii], avant de partir pour Kyoto. Mathieu quitte le Japon le 19 septembre, tandis que Tapié y reste pour son exposition d’art informel « Sekaï Gendaï Geijutsu Ten » (l’art contemporain dans le monde) au musée Bridgestone à Tōkyō [lxviii].
Ce voyage aura permis à Mathieu d’étendre sa notoriété au pays du Soleil levant, tandis qu’il fera de Tapié, « très impressionné par la qualité d’ensemble [lxix] » du travail des artistes Gutaï, leur défenseur et critique attitré.
Compagnons de route du renouveau artistique
Les chemins de Mathieu et Tapié finiront par s’éloigner du fait de considérations commerciales et de désaccords théoriques, même s’il leur arrivera de se recroiser à la galerie Stadler. Georges Mathieu et Michel Tapié partagèrent une décennie durant à la fois une amitié et des intérêts communs, entre le brio intransigeant de l’un et les contradictions élégantes [lxx] de l’autre. Le prosélytisme [lxxi] de Tapié dont Mathieu fut l’objet peut être comparé à celui du critique américain Clement Greenberg pour Pollock. Ce rare duumvirat peintre/critique, œuvrant dans une symbiose mutualiste, est à l’origine d’un défrichage pionnier du secteur artistique, chacun faisant appel à ses propres méthodes : l’activisme zélé pour Mathieu et le dilettantisme aventurier pour Tapié. Ils furent les plus efficaces acteurs et théoriciens du développement de l’abstraction libre. Si celle-ci fut finalement supplantée dans l’imaginaire collectif par l’expressionnisme abstrait [lxxii] puis le pop art d’outre-Atlantique, elle doit être redécouverte aujourd’hui à la lumière de la variété esthétique et conceptuelle de sa production picturale, à l’aune de son avant-gardisme, de ses développements internationaux et de ses ambitions universalistes, à la mesure de son irréfutable envergure.
Édouard Lombard
Directeur du Comité Georges Mathieu
_____________________
[i] Aussi appelée abstraction chaude par opposition à l’abstraction froide de l’école géométrique.
[ii] Alfred Otto Wolfgang Schulze dit Wols (° 27 mai 1913 † 1er septembre 1951).
[iii] En italique dans le texte.
[iv] Combat, no 1018, 16 octobre 1947.
[v] Survivance, Conception et Désintégration.
[vi] Exorcisme et Incantation.
[vii] Combat, no 1018, 16 octobre 1947.
[viii] Georges Mathieu, Au-delà du tachisme, 1963, Julliard, p. 46.
[ix] Michel Tapié ne participe pas à l’organisation de l’exposition « L’imaginaire », pas plus qu’à celle de l’exposition « H.W.P.S.M.T.B. », comme l’indique abusivement l’addendum de la réédition par Artcurial en 1994 de l’ouvrage de 1952 de Michel Tapié Un art autre. Mathieu le note d’ailleurs en marge de l’exemplaire de cet ouvrage présent dans ses archives personnelles.
[x] Georges Mathieu, Au-delà du tachisme, 1963, Julliard, p. 52.
[xi] Ultérieurement dénommée Florence Houston-Brown.
[xii] Déjà employé en 1945 dans La Voix de Paris par le critique conservateur Jerzy Waldemar Jarocinski, dit Waldemar-George, à propos de Fautrier (Frédérique Villemur et Brigitte Pietrzak in Paul Facchetti, le Studio, art informel et abstraction lyrique, 2004, Actes Sud, p. 14 ; Serge Guilbaut, « Disdain for the Stain: Abstract Expressionism and Tachisme », p. 41, in Abstract Expressionism, The International Context, Rutgers University Press, 2007), puis par Jean Dubuffet en 1946 dans ses Notes pour les fins-lettrés, dont le premier texte est titré « Partant de l’informe » ; l’écrivain Georges Bataille y a recours dès 1929 dans son Dictionnaire critique.
[xiii] Pour l’exposition « Véhémences confrontées ».
[xiv] Georges Mathieu, Au-delà du tachisme, 1963, Julliard, p. 61.
[xv] La seule exposition personnelle de Mathieu qui précède celle à la galerie Drouin fut celle à la librairie Dutilleux à Douai en 1942. Le duo Mathieu et Looten sera présenté à nouveau par Tapié à Lille en avril 1953 à la galerie Marcel Évrard.
[xvi] Dans une mise en page avant-gardiste que Mathieu continuera d’utiliser durant la décennie, dans la revue United States Lines Paris Review qu’il créera en 1953.
[xvii] Souligné dans le texte.
[xviii] Georges Mathieu, Au-delà du tachisme, 1963, Julliard, p. 208.
[xix] Qui fait circuler le paquebot America sur la ligne Le Havre–New York.
[xx] Mathieu affirme être « le premier à les mentionner à Estienne, à Jaguer, à Guilly, à Tapié » (Georges Mathieu, Au-delà du tachisme, 1963, Julliard, p. 59).
[xxi] Avec des œuvres de Bryen, De Kooning, Gorky, Hartung, Mathieu, Picabia, Pollock, Reinhardt, Rothko, Russell, Sauer, Tobey et Wols.
[xxii] « Mathieu pressed them [Charles Egan, Julien Levy, and Betty Parsons] but obtained only a few, unimpressive works on paper » (Catherine Dossin, The Rise and Fall of American Art, 1940-1980, 2015, Ashgate, p. 61).
[xxiii] Notamment grâce au prêt par l’artiste américain Alfonso Ossorio d’œuvres sur toile de Pollock et De Kooning provenant de sa collection personnelle.
[xxiv] Cf. Michel Tapié, Un art autre, 1952, Gabriel-Giraud et fils.
[xxv] L’ancêtre de The Paris Review.
[xxvi] Georges Mathieu, « Portrait of the Critic », Paris News Post, juin 1951.
[xxvii] Dont le nom intégral est Georges Victor Adolphe Mathieu d’Escaudœuvres.
[xxviii] Lettre du 10 janvier 1951, archives Michel Tapié, bibliothèque Kandinsky, Paris, citée par Juliette Evezard pour le catalogue d’exposition L’Aventure de Michel Tapié, un art autre, Luxembourg, 2016.
[xxix] Cf. Georges Mathieu, Au-delà du tachisme, 1963, Julliard, p. 73.
[xxx] 2 m × 4 m, actuellement dans les collections du Centre Pompidou / MNAM, Paris.
[xxxi] Kristine Stiles, Peinture, photographie, performance : le cas de Georges Mathieu, catalogue d’exposition de la rétrospective Mathieu au Jeu de Paume, 2003, p. 77.
[xxxii] Frédérique Villemur et Brigitte Pietrzak, Paul Facchetti, le Studio, art informel et abstraction lyrique, 2004, Actes Sud, p. 27.
[xxxiii] Par Stuart Preston le 9 novembre 1952, cf. Daniel Abadie, in Georges Mathieu, catalogue d’exposition de la rétrospective Mathieu au Jeu de Paume, 2003, p. 263.
[xxxiv] Sous-titré « où il s’agit de nouveaux dévidages du réel » et qu’une citation d’André Malraux utilisée en épigraphe semble placer sous son autorité intellectuelle.
[xxxv] Michel Tapié, Un art autre, 1952, Gabriel-Giraud et fils.
[xxxvi] Ce qui en fait l’artiste le plus représenté.
[xxxvii] Georges Mathieu, Au-delà du tachisme, 1963, Julliard, p. 81.
[xxxviii] Actuellement dans les collections du Centre Pompidou / MNAM, Paris.
[xxxix] Dans la même rubrique qui avait fait paraître en mai 1951 Pollock Paints a Painting.
[xl] Xavier Girard, interview de Jean Larcade, « Jean Larcade, la galerie Rive Droite », Art Press, juillet 1988, p. 33.
[xli] 2,95 m × 6 m, actuellement dans les collections du Centre Pompidou / MNAM, Paris.
[xlii] Xavier Girard, interview de Jean Larcade, « Jean Larcade, la galerie Rive Droite », Art Press, juillet 1988, p. 34.
[xliii] Hébergé désormais par le Centre Pompidou.
[xliv] Cf. Daniel Abadie, Georges Mathieu, op. cit., p. 264.
[xlv] Georges Mathieu, Cinquante ans de création, 2003, Hervas, p. 56.
[xlvi] Georges Mathieu, Au-delà du tachisme, 1963, Julliard, p. 97.
[xlvii] Publié par George Wittenborn à New York.
[xlviii] Le peintre américain Paul Jenkins ayant obtenu sa première exposition personnelle au Studio Facchetti en 1954.
[xlix] Texte original publié en anglais : « His activity during the last ten years reveals itself as of major importance. […] Michel Tapié will have had the great merit of venturing into this domain with extraordinary capacities of investigation and lightning insight. »
[l] Marcel Cohen et Rodolphe Stadler, Galerie Stadler, trente ans de rencontres, de recherches, de partis pris, 1955-1985, Galerie Stadler, 1985, p. 6.
[li] Cf. Thomas R. H. Havens, Radicals and Realists in the Japanese Nonverbal Arts: The Avant-garde Rejection of Modernism, 2006, University of Hawaii Press, p. 93.
[lii] Shoichi Hirai, ‘Paris et l’art japonais depuis la guerre – Réflexions autour des tendances des années cinquante’ in Paris du monde entier. Artistes étrangers à Paris 1900-2005, cat. expo., Tokyo, Asahi Shimbun, Paris, Centre Georges Pompidou, 2007.
[liii] Cf. Thomas R. H. Havens, Radicals and Realists in the Japanese Nonverbal Arts : The Avant-garde Rejection of Modernism, 2006, University of Hawaii Press, p. 94.
[liv] 具体 qui, composé des idéogrammes signifiant « outil » et « corps », signifie « concret » en japonais.
[lv] Cf. Ming Tiampo, Gutai – Decentering Modernism, 2011, University of Chicago Press, p. 91.
[lvi] Jirō Yoshihara, Gutai bijutsu sengen, Geijutsu Shinchō, décembre 1956.
[lvii] Cf. Éric Mézil, « ‘Nul n’est prophète en son pays’, le cas de Michel Tapié », in : Gutai, exhibition catalogue, Paris, Éditions du Jeu de Paume, 1999, p. 30-31.
[lviii] Georges Mathieu, Cinquante ans de création, 2003, Hervas, p. 63.
[lix] Également intitulée Bataille de Kōan, sachant qu’il s’agit la seconde bataille de la baie de Hakata, en 1281.
[lx] Georges Mathieu, Cinquante ans de création, 2003, Hervas, p. 63.
[lxi] Sachant qu’il s’agit de la première bataille de la baie de Hakata, en 1274.
[lxii] Fondateur de l’école d’art floral Ikebana Sōgetsu.
[lxiii] Qui deviendra en 1959 le premier directeur du Musée national d’art occidental à Tokyo, cf. Réna Kano, sous la direction de Didier Schulmann, « Georges Mathieu, Voyage et peintures au Japon, août-septembre 1957 », mémoire d’étude, 2009 ; il affirmera que Mathieu est « le plus grand peintre français depuis Picasso » (Patrick Grainville et Gérard Xuriguera, Mathieu, 1993, Nouvelles Éditions Françaises).
[lxiv]Le quotidien japonais le plus lu.
[lxv] Georges Mathieu, Cinquante ans de création, 2003, Hervas, p. 63 ; œuvre aussi appelée Hideyoshi Toyotomi.
[lxvi] Georges Mathieu, Au-delà du tachisme, 1963, Julliard, p. 129.
[lxvii] Cf. Réna Kano, sous la direction de Didier Schulmann, « Georges Mathieu, Voyage et peintures au Japon, août-septembre 1957 », mémoire d’étude, 2009.
[lxviii] Ainsi que pour accueillir Sam Francis qui arrive le 20 septembre pour son exposition.
[lxix] Kōichi Kawasaki, Le Séjour de Georges Mathieu au Japon, catalogue d’exposition de la rétrospective Mathieu au Jeu de Paume, 2003, p. 95.
[lxx] Pour reprendre les termes de Pierre Guéguen, Aujourd’hui, n°6, 1956.
[lxxi] Cf. Frederick Gross, Mathieu Paints a Painting, 2002, City University of New York.
[lxxii] Qui fut défendu par un efficace réseau d’influence et favorisée par une fragmentation et une absence de consensus en France et en Europe, cf. Serge Guilbaut, « Disdain for the Stain: Abstract Expressionism and Tachisme », p. 39, in Abstract Expressionism, The International Context, Rutgers University Press, 2007.